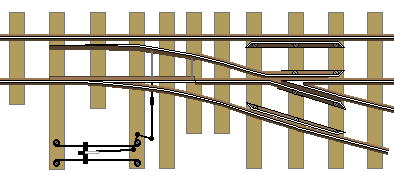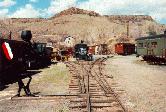La voie - Les aiguillages
Au début des chemins de fer, les changements de voie étaient
problématiques. Les stations terminales possédaient des plaques tournantes
pour retourner les locomotives et des ponts roulants pour faire changer les wagons de voie.
Certaines lignes étaient même en boucle fermée et les trains circulaient
toujours dans le même sens. Au fil du temps, les aiguillages ont évolué
en se simplifiant.
Les aiguillages à lames
+ Mécanique assez simple
+ En cas de talonnage, le mécanisme de manœuvre risque fort de casser, mais
les wagons ne quittent pas les rails.
Ces aiguillages sont les plus employés, même les lignes TGV en possèdent,
avec des cœurs à lame mobile.
Photos des aiguillages Anatomie d'un aiguillage
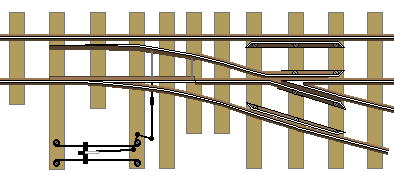

Les aiguillages «stub»
+ Mécanique simple
+ Absence de lame d'aiguillage (toutes les pièces sont des rails)
- Non talonnable (déraillement assuré en cas de talonnage)
- Passage à très faible vitesse
On en trouve encore quelques uns sur des quais de ports ou dans des cours d'usine,
bien souvent noyés par du goudron.
Outre Atlantique (Etats-Unis, Canada), ces aiguillages ont été très
utilisés dans les chemins de fer forestiers et on en trouve encore en bon état
dans des musées ferroviaires.

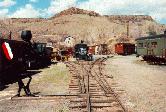


Les ponts roulants
+ Mécanique simple
+ Absence de lame d'aiguillage (toutes les pièces sont des rails)
- Non talonnable (déraillement assuré)
- Appareil hydraulique complexe pour la translation du pont
Le Pilatus Bahn, en Suisse, qui relie le village d'Alpnachstadt au sommet du mont Pilate,
est le chemin de fer le plus escarpé du monde avec une rampe moyenne de 42%.
L'unique croisement de la ligne possède deux ponts transbordeurs supportant chacun
une portion complète de voie. Il faut dire que le système de crémaillère
à denture bilatérale ne permet pas beaucoup de fantaisies au matériel roulant.
La preuve? c'est tout simplement que cette ligne n'a jamais connu de déraillement depuis son
ouverture en 1889.

Voie Anatomie d'un aiguillage